Bruegel, le moulin et la croix relève au moins deux défis : faire vivre une toile de maître et y apporter un éclairage. Le film est co-scénarisé par Michael Gibson, historien de l’art qui a consacré un essai sur le tableau qui fait l’objet du film, intitulé Le portement de la croix. Peint par Bruegel l’ancien en 1564, l’oeuvre comporte de nombreuses énigmes que Gibson a tenté d’éclaircir : “Pourquoi le peintre a-t-il dissimulé la figure centrale du Christ parmi une foule de paysans ? Pourquoi, dans un paysage Renaissance, a-t-il donné une importance considérable à
un improbable moulin perché sur un énigmatique rocher ? Pourquoi les gendarmes qui encadrent la procession sont-ils en uniforme rouge ? Que signifie le style
archaïsant des saintes femmes ? Passé et futur, vie et mort, destin et liberté façonnent cette fresque foisonnante.” (Gibson, dans son essai The Mill and The Cross). Le tableau, exposé dans un musée à Vienne, comprend effectivement de nombreuses scènes et environ 500 personnages avec une grande diversité d’expressions et d’attitudes. On pourra remarquer par exemple que la plupart des regards sont détournés de la scène centrale où figure le Christ portant sa croix. Les cinéastes en donnent une explication assez plausible en faisant parler Bruegel qui explique à son ami que tous les événements qui ont changé le monde ne sont pas regardés par la foule. De même, le Christ est noyé au centre du tableau au milieu de nombreux personnages et dominé par un immense et mystérieux moulin. Il est donc à la fois mis en évidence par sa position centrale et dissimulé par sa taille et les détails qui l’entourent. Pour les cinéastes encore, le moulin ne serait autre que la figure de Dieu qui domine le monde et
distribue aux hommes son pain.
Le tableau regorge donc de questions que le film soulève grâce à un procédé assez novateur. Certes, toutes les techniques utilisées existent déjà : prises de vue sur fond bleu ou vert, incrustations numériques, matte painting... mais elles sont mises au service d’une impressionnante pénétration de l’oeuvre picturale. L’univers du tableau est très bien rendu, les personnages mis en scène respectent parfaitement l’ambiance de l’oeuvre et le contexte historique. Le spectateur pourra aisément se laisser porter dans ce voyage initiatique au coeur d’une peinture d’une grande richesse. Bien sûr, il faudra s’abandonner à la contemplation et oublier qu’il s’agit d’un film car s’il s’agit bien de cinéma; on est très loin du paysage cinématographique habituel. Mais il ne faut
pas non plus se méprendre. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur la vie de Bruegel ou sur l’analyse de son oeuvre. Nous sommes indiscutablement dans une fiction symbolique qui puise ses ressources dans l’imaginaire du grand maître. Les cinéastes ont extrait du tableau quelques personnages significatifs pour en raconter l’histoire probable d’une de leur journée. C’est d’ailleurs là que le film s’affranchit de son objet, le tableau, pour livrer au spectateur une vision subjective de l’histoire.
Pour en comprendre le message, il convient de resituer le contexte. En 1564, date de réalisation du tableau, le comté de Flandres connaît un époque difficile sous la domination de Philippe II d’Espagne, fils de Charles Quint. C’est aussi à cette époque que le protestantisme luthérien puis calviniste se répand comme
une traînée de poudre. Il va en découler de violentes guerres civiles et religieuses entre catholiques et protestants. La guerre de Quatre-vingts ans (encore appelée “révolte des gueux”) débutera d’ailleurs en 1568. C’est ainsi que les cinéastes interprètent dans le tableau la présence de cavaliers en tunique rouge comme représentant le joug espagnol. Il s’ensuit de la part du réalisateur Lech Majewski et de l’historien Gibson une vision semble-t-il partisane de la situation. Il est assez difficile de percevoir le message exact du film car il est construit par un jeu de symbolisme et de références picturales et historiques. En outre, les deux hommes ne se sont pas beaucoup exprimé sur leurs intentions (sauf si le livre de Gibson est plus clair). Néanmoins, de notre point de vue, il faudrait comprendre que ce qui semble représenter une forme de l’inquisition espagnole a été une abominable tyrannie faite de jugement sommaire et de cruauté. Ainsi voit-on un paisible paysan se faire battre par les cavaliers
rouges et laissé pour mort ligoté à une roue semblable à celle peinte à droite du tableau. De même, une femme accompagnée de soldat et de clercs est enterrée vivante, menacée par leurs lances. Laissons aux historiens le soin de contrôler la véracité de ces supplices. Le plus important est l’analogie faite entre le portement de la croix et la mise à mort d’un prédicateur de la Réforme protestante. En effet, on comprend par bribes que le supplicié qui prend la place du Christ sur le chemin de la croix est en réalité un protestant condamné à mort par les Espagnols. Par ailleurs, on devine qu’un personnage allégorique n’est autre que Judas lorsqu’il jette de rage sur le sol d’une église une bourse de pièces d’or et finit par se pendre quelques plans plus loin. En rassemblant tous ces éléments et à défaut d’une interprétation plus pertinente, on pourrait résumer le message en disant que les chrétiens espagnols ont fait aux protestants ce que les juifs ont fait au Christ. Il s’agit là d’une vision particulièrement
parcellaire de l’histoire qui non seulement ne paraît pas ressortir explicitement du tableau, mais qui fait abstraction de la violence bilatérale des guerres de religions (les iconoclastes calvinistes n’avaient pas non plus une grande tendresse à l’égard de leurs ennemis).
En bref, le film touche, ou plutôt effleure très discrètement par voie d’obscures métaphores le très délicat sujet des guerres de religion en jetant partialement la suspicion sur l'Église catholique et surtout en paraissant détourner l’oeuvre de Bruegel. C’est plutôt dommage au regard de sa qualité artistique et de son potentiel scientifique.
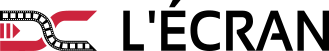
Bruegel, le moulin et la croix relève au moins deux défis : faire vivre une toile de maître et y apporter un éclairage. Le film est co-scénarisé par Michael Gibson, historien de l’art qui a consacré un essai sur le tableau qui fait l’objet du film, intitulé Le portement de la croix. Peint par Bruegel l’ancien en 1564, l’oeuvre comporte de nombreuses énigmes que Gibson a tenté d’éclaircir : “Pourquoi le peintre a-t-il dissimulé la figure centrale du Christ parmi une foule de paysans ? Pourquoi, dans un paysage Renaissance, a-t-il donné une importance considérable à
un improbable moulin perché sur un énigmatique rocher ? Pourquoi les gendarmes qui encadrent la procession sont-ils en uniforme rouge ? Que signifie le style
archaïsant des saintes femmes ? Passé et futur, vie et mort, destin et liberté façonnent cette fresque foisonnante.” (Gibson, dans son essai The Mill and The Cross). Le tableau, exposé dans un musée à Vienne, comprend effectivement de nombreuses scènes et environ 500 personnages avec une grande diversité d’expressions et d’attitudes. On pourra remarquer par exemple que la plupart des regards sont détournés de la scène centrale où figure le Christ portant sa croix. Les cinéastes en donnent une explication assez plausible en faisant parler Bruegel qui explique à son ami que tous les événements qui ont changé le monde ne sont pas regardés par la foule. De même, le Christ est noyé au centre du tableau au milieu de nombreux personnages et dominé par un immense et mystérieux moulin. Il est donc à la fois mis en évidence par sa position centrale et dissimulé par sa taille et les détails qui l’entourent. Pour les cinéastes encore, le moulin ne serait autre que la figure de Dieu qui domine le monde et
distribue aux hommes son pain.
Le tableau regorge donc de questions que le film soulève grâce à un procédé assez novateur. Certes, toutes les techniques utilisées existent déjà : prises de vue sur fond bleu ou vert, incrustations numériques, matte painting... mais elles sont mises au service d’une impressionnante pénétration de l’oeuvre picturale. L’univers du tableau est très bien rendu, les personnages mis en scène respectent parfaitement l’ambiance de l’oeuvre et le contexte historique. Le spectateur pourra aisément se laisser porter dans ce voyage initiatique au coeur d’une peinture d’une grande richesse. Bien sûr, il faudra s’abandonner à la contemplation et oublier qu’il s’agit d’un film car s’il s’agit bien de cinéma; on est très loin du paysage cinématographique habituel. Mais il ne faut
pas non plus se méprendre. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur la vie de Bruegel ou sur l’analyse de son oeuvre. Nous sommes indiscutablement dans une fiction symbolique qui puise ses ressources dans l’imaginaire du grand maître. Les cinéastes ont extrait du tableau quelques personnages significatifs pour en raconter l’histoire probable d’une de leur journée. C’est d’ailleurs là que le film s’affranchit de son objet, le tableau, pour livrer au spectateur une vision subjective de l’histoire.
Pour en comprendre le message, il convient de resituer le contexte. En 1564, date de réalisation du tableau, le comté de Flandres connaît un époque difficile sous la domination de Philippe II d’Espagne, fils de Charles Quint. C’est aussi à cette époque que le protestantisme luthérien puis calviniste se répand comme
une traînée de poudre. Il va en découler de violentes guerres civiles et religieuses entre catholiques et protestants. La guerre de Quatre-vingts ans (encore appelée “révolte des gueux”) débutera d’ailleurs en 1568. C’est ainsi que les cinéastes interprètent dans le tableau la présence de cavaliers en tunique rouge comme représentant le joug espagnol. Il s’ensuit de la part du réalisateur Lech Majewski et de l’historien Gibson une vision semble-t-il partisane de la situation. Il est assez difficile de percevoir le message exact du film car il est construit par un jeu de symbolisme et de références picturales et historiques. En outre, les deux hommes ne se sont pas beaucoup exprimé sur leurs intentions (sauf si le livre de Gibson est plus clair). Néanmoins, de notre point de vue, il faudrait comprendre que ce qui semble représenter une forme de l’inquisition espagnole a été une abominable tyrannie faite de jugement sommaire et de cruauté. Ainsi voit-on un paisible paysan se faire battre par les cavaliers
rouges et laissé pour mort ligoté à une roue semblable à celle peinte à droite du tableau. De même, une femme accompagnée de soldat et de clercs est enterrée vivante, menacée par leurs lances. Laissons aux historiens le soin de contrôler la véracité de ces supplices. Le plus important est l’analogie faite entre le portement de la croix et la mise à mort d’un prédicateur de la Réforme protestante. En effet, on comprend par bribes que le supplicié qui prend la place du Christ sur le chemin de la croix est en réalité un protestant condamné à mort par les Espagnols. Par ailleurs, on devine qu’un personnage allégorique n’est autre que Judas lorsqu’il jette de rage sur le sol d’une église une bourse de pièces d’or et finit par se pendre quelques plans plus loin. En rassemblant tous ces éléments et à défaut d’une interprétation plus pertinente, on pourrait résumer le message en disant que les chrétiens espagnols ont fait aux protestants ce que les juifs ont fait au Christ. Il s’agit là d’une vision particulièrement
parcellaire de l’histoire qui non seulement ne paraît pas ressortir explicitement du tableau, mais qui fait abstraction de la violence bilatérale des guerres de religions (les iconoclastes calvinistes n’avaient pas non plus une grande tendresse à l’égard de leurs ennemis).
En bref, le film touche, ou plutôt effleure très discrètement par voie d’obscures métaphores le très délicat sujet des guerres de religion en jetant partialement la suspicion sur l'Église catholique et surtout en paraissant détourner l’oeuvre de Bruegel. C’est plutôt dommage au regard de sa qualité artistique et de son potentiel scientifique.