Hollywoodland
em> a vu le jour grâce au travail de fans de la première heure des aventures de Superman, le producteur Glenn Williamson et le scénariste Paul Bernbaum. L’enjeu était de dévoiler l’individu qui se cachait derrière cette idole du cinéma, et qui ne put se défaire du costume de Superman qui limitait de façon frustrante ses ambitions. « Nous avons affaire à un thème qui fascinera toujours les gens : la mort tragique d'un personnage que l'on croit invincible. Pour toute une génération, la disparition de George Reeves équivaut à la fin d'une icône, la perte d'un repère. Il suffit de lire les unes des journaux après son décès : “Superman est mort” mais pas “George Reeves est mort”. C'est pourquoi nous tenions à dévoiler sa vraie personnalité » explique le producteur.
Film policier qui écorne l’image d’Épinal de la planète Hollywood, Hollywoodland est en premier lieu servi par un casting de stars a priori enthousiasmant. Il convient de retenir la performance de Ben Affleck,
récompensé lors de la 63° édition de la Mostra de Venise, touchant dans le rôle ambivalent d’un super-héros pour enfants dont l’uniforme va corseter sa carrière et modifier la perception de l’homme qui le porte. L’acteur interprète un George Reeves à la fois fascinant et pathétique par un jeu habile, tout en ellipse et en retenue, cachant derrière un sourire ou une bravade un vide qui — saura-t-on dans quelle mesure ? — contribuera à sa déchéance. La dimension humaine de cette gloire emblématique de l’âge d’or hollywoodien (tant dans son parcours que dans sa chute), est révélée aussi par la présence de Toni Mannix, la femme d’un grand manitou de la MGM, Eddie Mannix, et amante de George Reeves dont elle orientera la carrière. Jouée par Diane Lane, Toni est une figure complexe, une femme très masculine mais fragile, bien installée dans le gratin du cinéma, riche et encore belle, mais qui a peur de la solitude et de la décadence de ses charmes, et donc jalouse de l’intérêt que son protégé suscite auprès
des jeunes personnes. Enfin, le détective Simo constitue un rôle ingrat, dans le sens où son enquête sert de faire-valoir aux autres personnages du film. Adrien Brody campe un personnage tout droit sorti des clichés du polar américain, alcoolique, sans foi ni autre loi que la sienne, âpre au succès, et en instance de divorce avec sa femme. Les tentatives destinées à donner de la profondeur au personnage ne sont pas concluantes tant elles ne font que renforcer l’impression de déjà-vu que dégage ce détective, en tout point assimilable à la typologie qu’en dresse la tradition du grand écran.
Le film se décompose en deux volets, la carrière de George Reeves et l’enquête de Louis Simo, la prétention de la réalisation étant de mettre en relation les deux personnages-clés. Ainsi le détective se prend d’amitié pour la figure posthume de l’acteur, jusqu’à revivre en instantané les derniers moments de Superman. La vie de Reeves et les recherches de Simo ont chacune un aspect visuel différent,
pour marquer la différence d’époque et le tournant culturel amorcé aux États-Unis, entre la tranquillité relative du jazz et la cacophonie du rock : le premier volet est sobre, les couleurs sont chaudes et la caméra fluide, tandis que le second est plus nerveux, avec des couleurs « délavées par le soleil de Californie » (ainsi que l’explique Jonathan Freeman, le directeur de la photographie). Les séquences se succèdent en alternant flash-back et temps « réel » dans une progression aboutissant à la mise en scène des « trois » morts de George Reeves, correspondant aux trois hypothèses soulevées à l’époque qui se solderaient par le décès de l’acteur. Dans l’ensemble la réalisation remplit son office, mais elle reste toutefois assez neutre en se cantonnant à jeter un œil spectateur sur les personnages, sans parvenir à transmettre toute la chaleur humaine des sentiments et des pensées qui les habitent. Ainsi, au nom de cette neutralité, aucune hypothèse quant à la mort de George Reeves n’est privilégiée, laissant
le public sur sa faim. En outre, aucune révolution n’est à attendre quant à la perception actuelle de l’industrie hollywoodienne des années 50-60, le film est un reflet édulcoré du cinéma noir (atmosphère sombre, langage volontiers dur ou grossier, scènes suggestives du reste rares).
Histoire de deux hommes « qui rêvaient d’être quelqu’un d’autre », Hollywoodland a pour ambition de révéler la réalité dissimulée derrière le masque des illusions, ce qui a séduit le réalisateur Allen Coulter. Le scénario évoque une réalité qui, en plus d’être plus sordide, est teintée de fatalisme, sentiment qui aurait conduit George Reeves au suicide. Mélancolique, voire aux accents désespérés, le film distille une tristesse ambiguë car suspendant le destin des personnages à une force supérieure, la fatalité, sans possibilité de prise en main de sa destinée. Or, s’il existe une providence, elle n’étouffe en aucun cas le libre-arbitre et la responsabilité de l’homme dans ce qu’il lui arrive, ce qui permet d’
ailleurs de condamner le suicide en tant qu’acte de découragement. Loin de le signaler, le film veut excuser largement l’acte de George Reeves, au point d’en faire un héros, victime du système, volonté d’ailleurs affirmée par le scénariste Paul Bernbaum.
Le film a le grand mérite de décortiquer sans complaisance un univers d’illusions mû par la vanité et le besoin d’être autant que de posséder. Les sirènes du tout-Hollywood sont aussi responsables de la chute de George Reeves, incapable de trouver son public en dehors de ses interprétations de Superman et de trouver les moyens matériels à une autre carrière.
Derrière la recherche d’une carrière, d’une place au soleil, se cache un vide que ni les distractions ni les richesses ne peuvent combler. Dans cet univers matérialiste, seul compte la satisfaction de ses besoins, quitte à se servir des autres (comme la jeune Léonore Lemmon, maîtresse de Reeves). La poursuite effrénée de ces désirs (d’ailleurs portés sans fard à l’écran) ne fait
que détourner l’homme de son accomplissement personnel.
NB : Les citations sont tirées des notes de production.
Stéphane JOURDAIN
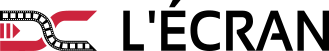
Hollywoodland
em> a vu le jour grâce au travail de fans de la première heure des aventures de Superman, le producteur Glenn Williamson et le scénariste Paul Bernbaum. L’enjeu était de dévoiler l’individu qui se cachait derrière cette idole du cinéma, et qui ne put se défaire du costume de Superman qui limitait de façon frustrante ses ambitions. « Nous avons affaire à un thème qui fascinera toujours les gens : la mort tragique d'un personnage que l'on croit invincible. Pour toute une génération, la disparition de George Reeves équivaut à la fin d'une icône, la perte d'un repère. Il suffit de lire les unes des journaux après son décès : “Superman est mort” mais pas “George Reeves est mort”. C'est pourquoi nous tenions à dévoiler sa vraie personnalité » explique le producteur.
Film policier qui écorne l’image d’Épinal de la planète Hollywood, Hollywoodland est en premier lieu servi par un casting de stars a priori enthousiasmant. Il convient de retenir la performance de Ben Affleck,
récompensé lors de la 63° édition de la Mostra de Venise, touchant dans le rôle ambivalent d’un super-héros pour enfants dont l’uniforme va corseter sa carrière et modifier la perception de l’homme qui le porte. L’acteur interprète un George Reeves à la fois fascinant et pathétique par un jeu habile, tout en ellipse et en retenue, cachant derrière un sourire ou une bravade un vide qui — saura-t-on dans quelle mesure ? — contribuera à sa déchéance. La dimension humaine de cette gloire emblématique de l’âge d’or hollywoodien (tant dans son parcours que dans sa chute), est révélée aussi par la présence de Toni Mannix, la femme d’un grand manitou de la MGM, Eddie Mannix, et amante de George Reeves dont elle orientera la carrière. Jouée par Diane Lane, Toni est une figure complexe, une femme très masculine mais fragile, bien installée dans le gratin du cinéma, riche et encore belle, mais qui a peur de la solitude et de la décadence de ses charmes, et donc jalouse de l’intérêt que son protégé suscite auprès
des jeunes personnes. Enfin, le détective Simo constitue un rôle ingrat, dans le sens où son enquête sert de faire-valoir aux autres personnages du film. Adrien Brody campe un personnage tout droit sorti des clichés du polar américain, alcoolique, sans foi ni autre loi que la sienne, âpre au succès, et en instance de divorce avec sa femme. Les tentatives destinées à donner de la profondeur au personnage ne sont pas concluantes tant elles ne font que renforcer l’impression de déjà-vu que dégage ce détective, en tout point assimilable à la typologie qu’en dresse la tradition du grand écran.
Le film se décompose en deux volets, la carrière de George Reeves et l’enquête de Louis Simo, la prétention de la réalisation étant de mettre en relation les deux personnages-clés. Ainsi le détective se prend d’amitié pour la figure posthume de l’acteur, jusqu’à revivre en instantané les derniers moments de Superman. La vie de Reeves et les recherches de Simo ont chacune un aspect visuel différent,
pour marquer la différence d’époque et le tournant culturel amorcé aux États-Unis, entre la tranquillité relative du jazz et la cacophonie du rock : le premier volet est sobre, les couleurs sont chaudes et la caméra fluide, tandis que le second est plus nerveux, avec des couleurs « délavées par le soleil de Californie » (ainsi que l’explique Jonathan Freeman, le directeur de la photographie). Les séquences se succèdent en alternant flash-back et temps « réel » dans une progression aboutissant à la mise en scène des « trois » morts de George Reeves, correspondant aux trois hypothèses soulevées à l’époque qui se solderaient par le décès de l’acteur. Dans l’ensemble la réalisation remplit son office, mais elle reste toutefois assez neutre en se cantonnant à jeter un œil spectateur sur les personnages, sans parvenir à transmettre toute la chaleur humaine des sentiments et des pensées qui les habitent. Ainsi, au nom de cette neutralité, aucune hypothèse quant à la mort de George Reeves n’est privilégiée, laissant
le public sur sa faim. En outre, aucune révolution n’est à attendre quant à la perception actuelle de l’industrie hollywoodienne des années 50-60, le film est un reflet édulcoré du cinéma noir (atmosphère sombre, langage volontiers dur ou grossier, scènes suggestives du reste rares).
Histoire de deux hommes « qui rêvaient d’être quelqu’un d’autre », Hollywoodland a pour ambition de révéler la réalité dissimulée derrière le masque des illusions, ce qui a séduit le réalisateur Allen Coulter. Le scénario évoque une réalité qui, en plus d’être plus sordide, est teintée de fatalisme, sentiment qui aurait conduit George Reeves au suicide. Mélancolique, voire aux accents désespérés, le film distille une tristesse ambiguë car suspendant le destin des personnages à une force supérieure, la fatalité, sans possibilité de prise en main de sa destinée. Or, s’il existe une providence, elle n’étouffe en aucun cas le libre-arbitre et la responsabilité de l’homme dans ce qu’il lui arrive, ce qui permet d’
ailleurs de condamner le suicide en tant qu’acte de découragement. Loin de le signaler, le film veut excuser largement l’acte de George Reeves, au point d’en faire un héros, victime du système, volonté d’ailleurs affirmée par le scénariste Paul Bernbaum.
Le film a le grand mérite de décortiquer sans complaisance un univers d’illusions mû par la vanité et le besoin d’être autant que de posséder. Les sirènes du tout-Hollywood sont aussi responsables de la chute de George Reeves, incapable de trouver son public en dehors de ses interprétations de Superman et de trouver les moyens matériels à une autre carrière.
Derrière la recherche d’une carrière, d’une place au soleil, se cache un vide que ni les distractions ni les richesses ne peuvent combler. Dans cet univers matérialiste, seul compte la satisfaction de ses besoins, quitte à se servir des autres (comme la jeune Léonore Lemmon, maîtresse de Reeves). La poursuite effrénée de ces désirs (d’ailleurs portés sans fard à l’écran) ne fait
que détourner l’homme de son accomplissement personnel.
NB : Les citations sont tirées des notes de production.
Stéphane JOURDAIN