Le réalisateur de Truman Capote (2006) change d'univers. Le voilà qui attaque un sujet maintes fois traité, et qui constitue par là-m&
ecirc;me un terrain miné : le sport collectif. Il est en effet difficile de rivaliser avec des films comme Jerry Maguire, de Cameron Crowe en 1996, Le plus beau des combats, de Boaz Yackin en 2000, ou encore Invictus de Clint Esatwood en 2009. C'est peut-être pour ça que ce nouveau film aborde la matière d'un point de vue peu commun. Michael De Luca en a conscience : « Bennett est un réalisateur qui possède la gravité et la maîtrise nécessaires pour révéler les aspects sous-jacents d’un tel récit. Les films de sport sont souvent de jolies métaphores de la vie, mais Bennett est parvenu à y insuffler une vraie modernité. »
Pas de grandes envolées sportives sur fond de musique cuivrée, pas d'entraîneur surexcité au ralenti près du banc de touche, motivant son é
quipe avec charisme et persuasion. Brad Pitt incarne Billy Beane, un sélectionneur. Il est derrière son bureau, loin du terrain qu'il ne fréquente qu'une fois dans le film, et manie bien mieux le téléphone que la chaleur de l'effort.
La mise en scène est alors réaliste, tournée même sur pellicule et non en haute définition comme c'est désormais la règle, ponctuées de capture d'écran de télévision, et la musique est extrêmement discrète.
Comme le raconte le livre Moneyball, de Michael Lewis en 2003, que ce film met à l'écran, Billy Beane a pris un risque énorme. Il a pris le parti, contre tous et particulièrement contre son entraîneur, incarné par un Philip Seymour Hoffman qui tenait déjà la tête d'affiche dans
le film Truman Capote, de choisir les joueurs non en fonction de leur personnalité, de leur combativité ou de leur excellence, mais d'après des tableaux statistiques élaborés par un jeune diplômé de Yale. Si ce choix a été payant, la méthode a été contestée, et le film décrédibilise involontairement la pertinence de cette option. Car il s'agit là de deux façons bien différentes de concevoir le sport.
Celui-ci peut être en effet centré sur la performance de joueurs qui se surpassent et donnent le meilleur d'eux-même pour arracher la victoire. C'est ce qui passionne les millions de téléspectateurs chaque semaine rivés sur leurs écrans. A l'instar des rêves de Pierre de Coubertin, l'important n'est alors pas tant de gagner que de participer.
Le film d&
eacute;fend cependant une deuxième vision. Billy Beane est l'homme qui a décentré le sport de son humanité pour le focaliser sur la victoire d'où, d'ailleurs, le titre du film. Comme il le dit dans le film, « Nous, si on gagne, avec ce budget et cette équipe, ce sont les règles du jeu qui vont changer. Et c’est ce que je veux. Je veux que tout cela ait du sens. » A première vue, pas de problème, mais le film montre parfaitement bien à quelles extrémités mène cet état d'esprit. Les joueurs sont vendus, achetés, revendus et rachetés. Ils ne sont que des pions impuissants au cœur d'une machine financière entièrement tournée vers la victoire et qui les broie. Brat Pitt alias Billy Beane licencie sans état d'âme des joueurs dont il a parfaitement conscience qu'ils ont déménagé pour s'installer pr&
egrave;s de leur équipe, que leur vie dépend de leur carrière. La méthode, au début de son application, a des semblants de gentillesse. Le sélectionneur donne leur chance à des joueurs qui avaient été pour différentes raisons (problèmes de bras, d'âge, etc.) écartés du système. On voit donc un joueur père de famille auparavant soucieux et maintenant débordant d'enthousiasme, serrant sa femme fort dans ses bras, tout dans sa joie d'être remis sur le terrain. Mais s'il savait, le pauvre homme, qu'il vient de mettre le pied sur un fil comme un funambule sans perche, à la merci du moindre caprice d'un logiciel informatique. Dans le film, Billy Beane explique à son nouvel assistant qu'il faut dire les choses de façon très directe aux concernés, interprétés dans le film par de vrais joueurs. Quelques uns de ceux auxquels il a donné
leur chance se voient ainsi renvoyés en une fraction de seconde, laissés totalement seuls face à leur désarroi.
C'est pourtant à ce mode de gestion brutal que le film rend hommage. « Ce qui m’a plu dans cette histoire, raconte Michael De Luca, c’est le courage de cet homme qui a été le seul, au bon moment et au bon endroit, à retourner tout un système de pensée. »
Le plus curieux, c'est que les travers du système adopté par Billy Beane sont précisément ce que le film dénonce en l'attribuant au premier système. « Les A’s se dressent contre le système, explique Brad Pitt, mais comment vont-ils survivre, comment vont-ils accéder à la compétition ? Même s’ils ont du
talent, ils sont broyés par un système qui exige des budgets démesurés, des équipes monstrueuses. » A voir le film, il est à craindre que le remède soit pire que le mal...
Indépendamment de ce thème principal traité par le film, un accent particulier est mis sur la relation entre le sélectionneur et sa fille. Celle-ci s'inquiète pour l'avenir de son père, qui a pris un gros risque, tandis que celui-ci se raccroche à elle dans ses moments noirs, mais si Kerris Dorsey incarne une jeune fille convaincante, avec ses airs de Carey Mulligan, le film peine à s'aventurer dans cette relation qui fait figure d'anecdote.
Un film qui loue la mathématisation dans le sport, donc, qui aurait gagné à
assumer les conséquences néfastes d'un tel système au lieu de simplement louer le combat de l'innovation. Brad Pitt incarne son rôle bien comme il faut, mais cela ne suffit pas.
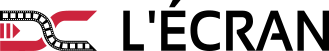
Un film réalisé de façon la plus réaliste possible, qui montre le rude affairisme du sport et raconte l'histoire vraie des deux personnes qui ont les premières institutionnalisé les statistiques comme mode de gestion.
Le réalisateur de Truman Capote (2006) change d'univers. Le voilà qui attaque un sujet maintes fois traité, et qui constitue par là-m&
ecirc;me un terrain miné : le sport collectif. Il est en effet difficile de rivaliser avec des films comme Jerry Maguire, de Cameron Crowe en 1996, Le plus beau des combats, de Boaz Yackin en 2000, ou encore Invictus de Clint Esatwood en 2009. C'est peut-être pour ça que ce nouveau film aborde la matière d'un point de vue peu commun. Michael De Luca en a conscience : « Bennett est un réalisateur qui possède la gravité et la maîtrise nécessaires pour révéler les aspects sous-jacents d’un tel récit. Les films de sport sont souvent de jolies métaphores de la vie, mais Bennett est parvenu à y insuffler une vraie modernité. »
Pas de grandes envolées sportives sur fond de musique cuivrée, pas d'entraîneur surexcité au ralenti près du banc de touche, motivant son é
quipe avec charisme et persuasion. Brad Pitt incarne Billy Beane, un sélectionneur. Il est derrière son bureau, loin du terrain qu'il ne fréquente qu'une fois dans le film, et manie bien mieux le téléphone que la chaleur de l'effort.
La mise en scène est alors réaliste, tournée même sur pellicule et non en haute définition comme c'est désormais la règle, ponctuées de capture d'écran de télévision, et la musique est extrêmement discrète.
Comme le raconte le livre Moneyball, de Michael Lewis en 2003, que ce film met à l'écran, Billy Beane a pris un risque énorme. Il a pris le parti, contre tous et particulièrement contre son entraîneur, incarné par un Philip Seymour Hoffman qui tenait déjà la tête d'affiche dans
le film Truman Capote, de choisir les joueurs non en fonction de leur personnalité, de leur combativité ou de leur excellence, mais d'après des tableaux statistiques élaborés par un jeune diplômé de Yale. Si ce choix a été payant, la méthode a été contestée, et le film décrédibilise involontairement la pertinence de cette option. Car il s'agit là de deux façons bien différentes de concevoir le sport.
Celui-ci peut être en effet centré sur la performance de joueurs qui se surpassent et donnent le meilleur d'eux-même pour arracher la victoire. C'est ce qui passionne les millions de téléspectateurs chaque semaine rivés sur leurs écrans. A l'instar des rêves de Pierre de Coubertin, l'important n'est alors pas tant de gagner que de participer.
Le film d&
eacute;fend cependant une deuxième vision. Billy Beane est l'homme qui a décentré le sport de son humanité pour le focaliser sur la victoire d'où, d'ailleurs, le titre du film. Comme il le dit dans le film, « Nous, si on gagne, avec ce budget et cette équipe, ce sont les règles du jeu qui vont changer. Et c’est ce que je veux. Je veux que tout cela ait du sens. » A première vue, pas de problème, mais le film montre parfaitement bien à quelles extrémités mène cet état d'esprit. Les joueurs sont vendus, achetés, revendus et rachetés. Ils ne sont que des pions impuissants au cœur d'une machine financière entièrement tournée vers la victoire et qui les broie. Brat Pitt alias Billy Beane licencie sans état d'âme des joueurs dont il a parfaitement conscience qu'ils ont déménagé pour s'installer pr&
egrave;s de leur équipe, que leur vie dépend de leur carrière. La méthode, au début de son application, a des semblants de gentillesse. Le sélectionneur donne leur chance à des joueurs qui avaient été pour différentes raisons (problèmes de bras, d'âge, etc.) écartés du système. On voit donc un joueur père de famille auparavant soucieux et maintenant débordant d'enthousiasme, serrant sa femme fort dans ses bras, tout dans sa joie d'être remis sur le terrain. Mais s'il savait, le pauvre homme, qu'il vient de mettre le pied sur un fil comme un funambule sans perche, à la merci du moindre caprice d'un logiciel informatique. Dans le film, Billy Beane explique à son nouvel assistant qu'il faut dire les choses de façon très directe aux concernés, interprétés dans le film par de vrais joueurs. Quelques uns de ceux auxquels il a donné
leur chance se voient ainsi renvoyés en une fraction de seconde, laissés totalement seuls face à leur désarroi.
C'est pourtant à ce mode de gestion brutal que le film rend hommage. « Ce qui m’a plu dans cette histoire, raconte Michael De Luca, c’est le courage de cet homme qui a été le seul, au bon moment et au bon endroit, à retourner tout un système de pensée. »
Le plus curieux, c'est que les travers du système adopté par Billy Beane sont précisément ce que le film dénonce en l'attribuant au premier système. « Les A’s se dressent contre le système, explique Brad Pitt, mais comment vont-ils survivre, comment vont-ils accéder à la compétition ? Même s’ils ont du
talent, ils sont broyés par un système qui exige des budgets démesurés, des équipes monstrueuses. » A voir le film, il est à craindre que le remède soit pire que le mal...
Indépendamment de ce thème principal traité par le film, un accent particulier est mis sur la relation entre le sélectionneur et sa fille. Celle-ci s'inquiète pour l'avenir de son père, qui a pris un gros risque, tandis que celui-ci se raccroche à elle dans ses moments noirs, mais si Kerris Dorsey incarne une jeune fille convaincante, avec ses airs de Carey Mulligan, le film peine à s'aventurer dans cette relation qui fait figure d'anecdote.
Un film qui loue la mathématisation dans le sport, donc, qui aurait gagné à
assumer les conséquences néfastes d'un tel système au lieu de simplement louer le combat de l'innovation. Brad Pitt incarne son rôle bien comme il faut, mais cela ne suffit pas.