L'histoire des Choristes est inspirée de La cage aux rossignols (1945) de Jean Dréville. Gérard Jugnot et Christophe Barratier reconnaissent tout deux leur amour pour « le vieux cinéma ». Ce point n’est pas anodin, car par « vieux cinéma » les deux maîtres d’oeuvres des Choristes entendent « la tradition de qualité française », que Truffaut conspua dans son célèbre article : « une certaine tendance du cinéma français » (in cahiers du cinéma N 31 janvier 1954). Ce film est donc l’héritier de René Clément, Jean Dréville, ou encore Claude Autant-Lara. C’est dire que la mise en scène ne pèche pas par une recherche stylistique et une originalité trop poussées. Le film a donc un côté vieillot, qui, sans être aussi insupportable que dans le cinéma dont il se veut l’héritier,
nous empêche tout de même de lui accorder beaucoup de crédit artistique.Le grand intérêt du film, c’est surtout la découverte de Jean-Baptiste Monier. Ce garçon n’a pas seulement une voix magnifique, c’est un acteur hors pair, au regard surprenant de beauté, à la jeunesse fière et noble. Il est regrettable que la psychologie peu poussée de son personnage gâche en partie des dons aussi exceptionnels. Espérons que nous le reverrons bientôt dirigé par un réalisateur un peu plus talentueux. Si le film n’est pas d’un grand intérêt pour le cinéphile, il est en revanche passionnant pour l’analyste, car il présente sans voile et presque avec naïveté les rouages de sa mécanique. Le plus important de ces rouages est le schéma de la consolation, dont l’équation serait : identification au personnage + admiration pour celui-ci = consolation du spectateur. Le meilleur moyen d’
expliquer ce schéma est de le voir à l’œuvre. Christophe Barratier dit lui même dans le dossier de presse que le fait que Clément Mathieu soit un musicien raté est extrêmement important. Pour dire les choses crûment, voici comment raisonne inconsciemment le spectateur : « comme Mathieu je suis un raté (nous pouvons tous dire celà), mais comme lui j’ai un grand cœur, et c’est là l’important ». La consolation a eu lieu. Ce schéma s’applique aussi au personnage de Pierre Morhange.
Le thème polyphonique principal est très agréable à entendre, mais on est surpris lorsque l’on fait un effort d’attention pour écouter les paroles. Essayons de même d’entendre ce que dit le film.
Tout d’abord, il y a un choeur, un groupe. Lorsque Clément Mathieu commence à faire chanter les garçons, il compose pour eux une sorte de chant de promotion, quelque chose comme : « nous sommes le fond de l’étang, ça c’est épatant... ». Bien vite,
la chorale va devenir un corps, auquel on est fier d’appartenir. Pour entrer dans ce groupe, les enfants, notamment Pierre Morhange, sont prêts à faire des efforts, à se discipliner. C’est donc un élément pédagogique de tout premier ordre.
Mais le choeur va rapidement devenir un parti. On est avec lui, ou contre lui. Tout est fait par les auteurs pour faire aimer ce parti au spectateur, lui faire désirer même d’en être, et donc, et c’est là que le bât blesse, lui faire détester ses opposants. Le monde du film se divisera à la fin entre les bons, ceux qui font partie de la chorale, et les méchants, ceux qui n’en font pas partie. Ainsi, monsieur Langlois, le professeur, était au début du film un méchant, mais il se convertit et devient le pianiste du groupe. Il sera sauvé. Ce n’est pas le cas du directeur et de la comtesse qui restent enfouis dans leurs bêtises et leurs méchancetés.
Voilà qui nous amène au second point, celui de la violente haine contre l’autorité qui suinte du film. Il est d’ailleurs très curieux, et disons le, inquiétant, de retrouver cette haine dans de nombreuses oeuvres populistes, tels que Love Story (à l’égard du père) ou Le cercle des poètes disparus (à l’égard du directeur et du père), à croire qu’elle est un élément essentiel au succès d’un film.
La haine entretenue chez le spectateur à l’égard de Rachin devient délirante à la fin du film. Rien ne semble justifier dramatiquement la destruction de l’école, si ce n’est l’assouvissement de la haine que le film, les auteurs, et par contagion, les spectateurs portent à Rachin, et à travers lui à l’autorité. Mathieu face à l’école qui flambe se contente de noter dans son journal : « c’était la légion d’honneur de Rachin et son avancement qui partaient en fumée ». Le principal tort de Rachin était de ne pas faire partie de la chorale.
style="font-size: x-small;">
Ainsi, comme toute œuvre démagogique, Les Choristes caressent le spectateur dans le sens du poil, qui est en général le mauvais sens. Les efforts des auteurs pour faire un film chamant sont cepandant louables, mais si il y a beaucoup de bons sentiments, il y a un manque inquiètant de grandeur. .Signalons enfin des citations de chansons grivoises, qui ne semblent pas avoir un grand intérêt pour l’intrigue.
Benoît d'ANDRE
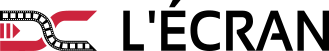
nous empêche tout de même de lui accorder beaucoup de crédit artistique.
Le grand intérêt du film, c’est surtout la découverte de Jean-Baptiste Monier. Ce garçon n’a pas seulement une voix magnifique, c’est un acteur hors pair, au regard surprenant de beauté, à la jeunesse fière et noble. Il est regrettable que la psychologie peu poussée de son personnage gâche en partie des dons aussi exceptionnels. Espérons que nous le reverrons bientôt dirigé par un réalisateur un peu plus talentueux.
Si le film n’est pas d’un grand intérêt pour le cinéphile, il est en revanche passionnant pour l’analyste, car il présente sans voile et presque avec naïveté les rouages de sa mécanique. Le plus important de ces rouages est le schéma de la consolation, dont l’équation serait : identification au personnage + admiration pour celui-ci = consolation du spectateur. Le meilleur moyen d’
expliquer ce schéma est de le voir à l’œuvre. Christophe Barratier dit lui même dans le dossier de presse que le fait que Clément Mathieu soit un musicien raté est extrêmement important. Pour dire les choses crûment, voici comment raisonne inconsciemment le spectateur : « comme Mathieu je suis un raté (nous pouvons tous dire celà), mais comme lui j’ai un grand cœur, et c’est là l’important ». La consolation a eu lieu. Ce schéma s’applique aussi au personnage de Pierre Morhange.
Le thème polyphonique principal est très agréable à entendre, mais on est surpris lorsque l’on fait un effort d’attention pour écouter les paroles. Essayons de même d’entendre ce que dit le film.
Tout d’abord, il y a un choeur, un groupe. Lorsque Clément Mathieu commence à faire chanter les garçons, il compose pour eux une sorte de chant de promotion, quelque chose comme : « nous sommes le fond de l’étang, ça c’est épatant... ». Bien vite,
la chorale va devenir un corps, auquel on est fier d’appartenir. Pour entrer dans ce groupe, les enfants, notamment Pierre Morhange, sont prêts à faire des efforts, à se discipliner. C’est donc un élément pédagogique de tout premier ordre.
Mais le choeur va rapidement devenir un parti. On est avec lui, ou contre lui. Tout est fait par les auteurs pour faire aimer ce parti au spectateur, lui faire désirer même d’en être, et donc, et c’est là que le bât blesse, lui faire détester ses opposants. Le monde du film se divisera à la fin entre les bons, ceux qui font partie de la chorale, et les méchants, ceux qui n’en font pas partie. Ainsi, monsieur Langlois, le professeur, était au début du film un méchant, mais il se convertit et devient le pianiste du groupe. Il sera sauvé. Ce n’est pas le cas du directeur et de la comtesse qui restent enfouis dans leurs bêtises et leurs méchancetés.
Voilà qui nous amène au second point, celui de la violente haine contre l’autorité qui suinte du film. Il est d’ailleurs très curieux, et disons le, inquiétant, de retrouver cette haine dans de nombreuses oeuvres populistes, tels que Love Story (à l’égard du père) ou Le cercle des poètes disparus (à l’égard du directeur et du père), à croire qu’elle est un élément essentiel au succès d’un film.
La haine entretenue chez le spectateur à l’égard de Rachin devient délirante à la fin du film. Rien ne semble justifier dramatiquement la destruction de l’école, si ce n’est l’assouvissement de la haine que le film, les auteurs, et par contagion, les spectateurs portent à Rachin, et à travers lui à l’autorité. Mathieu face à l’école qui flambe se contente de noter dans son journal : « c’était la légion d’honneur de Rachin et son avancement qui partaient en fumée ». Le principal tort de Rachin était de ne pas faire partie de la chorale.
style="font-size: x-small;">
Ainsi, comme toute œuvre démagogique, Les Choristes caressent le spectateur dans le sens du poil, qui est en général le mauvais sens. Les efforts des auteurs pour faire un film chamant sont cepandant louables, mais si il y a beaucoup de bons sentiments, il y a un manque inquiètant de grandeur. .Signalons enfin des citations de chansons grivoises, qui ne semblent pas avoir un grand intérêt pour l’intrigue.