Michel Ocelot signe un film d'animation d'une très grande simplicité (des ombres chinoises étagées sur un fond coloré grâce à une 3D assez superflue) mais, à en croire les réactions des enfants dans la salle, assez efficace. Le réalisateur des fameux Kirikou (Kirikou et la sorcière en 1998
span>, Kirikou et les bêtes sauvages en 2005 et Kirikou et les hommes et les femmes prévu en 2012) sert donc six contes pour enfants dans des décors variés : le moyen-âge, la période aztèque, les Antilles, l'Afrique et le Tibet...
Il n'est pas innocent que chaque conte mette en scène un homme et une femme : « j’ai commencé il y a vingt ans cette collection d’historiettes avec un garçon et une fille, je continue. » (in Dossier de presse), et ce choix est déterminé par une prise de position résolument féministe: « je tiens aussi à toujours donner une place éminente aux femmes, qu’elles devraient avoir naturellement. Un peu partout dans le monde, les hommes sont des tortionnaires, les femmes des victimes.
On peut presque parler de génocide. Dès le début de ma vie, j’ai eu la chance d’avoir des femmes dans ma vie, une maman et une petite soeur, c’était bien, et rien ne justifiait une hiérarchie. Et plus tard, je n’ai jamais eu d’amies qui auraient eu une position subalterne. Bref, il y a des héroïnes dans mes histoires. »
Chaque histoire contient une petite morale parfois tellement implicite que ce ne semble pas être le souci du cinéaste : « j’ai un peu de mal à analyser mes travaux, cela ne m’intéresse pas. Mais après coup, je peux trouver que, en général, mes héros sont des innocents qui ne se laissent pas faire. Ils savent résister à l’abus de pouvoir, à la méchanceté, à la sottise, à la superstition. Souvent, ils sont aussi généreux. » Du coup, les enseignements du film sont assez inégaux.
Du premier conte
en effet, narrant l'histoire d'un prince-loup-garou, on peut en effet tirer la leçon que la gentillesse et la ténacité triomphent toujours. Au temps où un jeune homme, injustement inculpé, croupissait en prison, une jeune fille amoureuse le couvrit de ses bienfaits. Mais à la sortie c'est sa méchante soeur qui usurpa cette générosité et se fiança avec lui. Lorsqu'elle apprit que son mari se transformait chaque nuit en loup-garou et ne pouvait retrouver forme humaine que grâce à une chaînette, elle fit disparaître le bijou dans un puits profond. Après quelques péripéties, elle finit par être confondue et tout rentre dans l'ordre.
Du deuxième récit ensuite, contant les exploits d'un jeune antillais dupant le roi du pays des morts, on peut déduire qu'un service rendu gratuitement nous est souvent profitable. Au lieu de tuer les monstres qui se dressent sur son chemin, le jeune homme décide en effet de les nourrir, se faisant ainsi des
alliés précieux au moment des trois énigmes fatales du monarque.
La troisième histoire projette le spectateur dans la période aztèque, au moment d'un sacrifice humain dont le rituel est singulièrement proche de la liturgie catholique : le grand-prêtre obscurantiste, appelé « grand berger, » finit une de ses formules par « … dans les siècles des siècles », aussitôt suivi par le peuple qui répond un « haaahaaa » proche de l' « amen. ». Peut-être également à cause de la musique, puisque Michel Ocelot a voulu « associer l’horreur imbécile de ces sacrifices à la beauté des choeurs que j’imaginais comme ceux de Verdi (Christian Maire, le compositeur, a fait des merveilles). ». Il faut déduire de cette histoire que l'obscurantisme doit être vaincu (par l'épée au besoin, pour filer la métaphore) afin que le peuple découvre la valeur du travail et de la fête (oui, si on n'a
pas fumé quelques herbes avant, on ne voit pas trop le rapport !).
Dans le quatrième conte un jeune africain, houspillé au village parce qu'il tambourine sur tout ce qu'il trouve, finit par devenir le sauveur des villageois grâce à un tambour magique qui oblige ses auditeurs à danser. Les qualités et saines aspirations méritent donc d'être développées contre vents et marées car elles sont potentiellement source de bienfaits pour les autres.
Dans le cinquième volet, une légende tibétaine met en scène un garçon qui dit toujours la vérité, qu'une vilaine princesse va chercher à faire mentir. Devant son échec, qui va coûter cher au jeune homme pour finalement lui rapporter gros, on doit reconnaître la grande vertu de l'honnêteté. A écouter Michel Ocelot, on a échappé au pire : « l'original est beaucoup plus révoltant : la femme qui séduit le
palefrenier est ’épouse du roi. Il n’y a aucune trace d’amour, sauf de la part du garçon qui tombe amoureux d’elle jusqu’à tuer le cheval. Mais finalement, c’est celui qui ne ment pas qui gagne… »
Dans la sixième partie, enfin, un évêque s'apprête à marier de force une jeune fille à un sorcier dans une grande cathédrale (trouvez l'intrus !). Mais le fils de l'architecte, amoureux de la belle, parvient à la faire enfuir. Vengeur, le sorcier transforme la jouvencelle en animal. Afin de conjurer le sortilège, le jeune homme entame une quête dont le but est de solliciter la « fée des caresses, » chose parfaitement inutile puisqu'il paraît que l'amour entre un homme et une femme est plus fort que toutes les magies (quelle buse ce fils d'architecte !). Enfin on apprend au passage que la gentillesse envers les animaux est une noble chose, parfois profitable.
Raphaël Jodeau
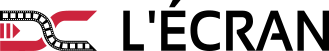
Michel Ocelot signe un film d'animation d'une très grande simplicité (des ombres chinoises étagées sur un fond coloré grâce à une 3D assez superflue) mais, à en croire les réactions des enfants dans la salle, assez efficace. Le réalisateur des fameux Kirikou (Kirikou et la sorcière en 1998
span>, Kirikou et les bêtes sauvages en 2005 et Kirikou et les hommes et les femmes prévu en 2012) sert donc six contes pour enfants dans des décors variés : le moyen-âge, la période aztèque, les Antilles, l'Afrique et le Tibet...
Il n'est pas innocent que chaque conte mette en scène un homme et une femme : « j’ai commencé il y a vingt ans cette collection d’historiettes avec un garçon et une fille, je continue. » (in Dossier de presse), et ce choix est déterminé par une prise de position résolument féministe: « je tiens aussi à toujours donner une place éminente aux femmes, qu’elles devraient avoir naturellement. Un peu partout dans le monde, les hommes sont des tortionnaires, les femmes des victimes.
On peut presque parler de génocide. Dès le début de ma vie, j’ai eu la chance d’avoir des femmes dans ma vie, une maman et une petite soeur, c’était bien, et rien ne justifiait une hiérarchie. Et plus tard, je n’ai jamais eu d’amies qui auraient eu une position subalterne. Bref, il y a des héroïnes dans mes histoires. »
Chaque histoire contient une petite morale parfois tellement implicite que ce ne semble pas être le souci du cinéaste : « j’ai un peu de mal à analyser mes travaux, cela ne m’intéresse pas. Mais après coup, je peux trouver que, en général, mes héros sont des innocents qui ne se laissent pas faire. Ils savent résister à l’abus de pouvoir, à la méchanceté, à la sottise, à la superstition. Souvent, ils sont aussi généreux. » Du coup, les enseignements du film sont assez inégaux.
Du premier conte
en effet, narrant l'histoire d'un prince-loup-garou, on peut en effet tirer la leçon que la gentillesse et la ténacité triomphent toujours. Au temps où un jeune homme, injustement inculpé, croupissait en prison, une jeune fille amoureuse le couvrit de ses bienfaits. Mais à la sortie c'est sa méchante soeur qui usurpa cette générosité et se fiança avec lui. Lorsqu'elle apprit que son mari se transformait chaque nuit en loup-garou et ne pouvait retrouver forme humaine que grâce à une chaînette, elle fit disparaître le bijou dans un puits profond. Après quelques péripéties, elle finit par être confondue et tout rentre dans l'ordre.
Du deuxième récit ensuite, contant les exploits d'un jeune antillais dupant le roi du pays des morts, on peut déduire qu'un service rendu gratuitement nous est souvent profitable. Au lieu de tuer les monstres qui se dressent sur son chemin, le jeune homme décide en effet de les nourrir, se faisant ainsi des
alliés précieux au moment des trois énigmes fatales du monarque.
La troisième histoire projette le spectateur dans la période aztèque, au moment d'un sacrifice humain dont le rituel est singulièrement proche de la liturgie catholique : le grand-prêtre obscurantiste, appelé « grand berger, » finit une de ses formules par « … dans les siècles des siècles », aussitôt suivi par le peuple qui répond un « haaahaaa » proche de l' « amen. ». Peut-être également à cause de la musique, puisque Michel Ocelot a voulu « associer l’horreur imbécile de ces sacrifices à la beauté des choeurs que j’imaginais comme ceux de Verdi (Christian Maire, le compositeur, a fait des merveilles). ». Il faut déduire de cette histoire que l'obscurantisme doit être vaincu (par l'épée au besoin, pour filer la métaphore) afin que le peuple découvre la valeur du travail et de la fête (oui, si on n'a
pas fumé quelques herbes avant, on ne voit pas trop le rapport !).
Dans le quatrième conte un jeune africain, houspillé au village parce qu'il tambourine sur tout ce qu'il trouve, finit par devenir le sauveur des villageois grâce à un tambour magique qui oblige ses auditeurs à danser. Les qualités et saines aspirations méritent donc d'être développées contre vents et marées car elles sont potentiellement source de bienfaits pour les autres.
Dans le cinquième volet, une légende tibétaine met en scène un garçon qui dit toujours la vérité, qu'une vilaine princesse va chercher à faire mentir. Devant son échec, qui va coûter cher au jeune homme pour finalement lui rapporter gros, on doit reconnaître la grande vertu de l'honnêteté. A écouter Michel Ocelot, on a échappé au pire : « l'original est beaucoup plus révoltant : la femme qui séduit le
palefrenier est ’épouse du roi. Il n’y a aucune trace d’amour, sauf de la part du garçon qui tombe amoureux d’elle jusqu’à tuer le cheval. Mais finalement, c’est celui qui ne ment pas qui gagne… »
Dans la sixième partie, enfin, un évêque s'apprête à marier de force une jeune fille à un sorcier dans une grande cathédrale (trouvez l'intrus !). Mais le fils de l'architecte, amoureux de la belle, parvient à la faire enfuir. Vengeur, le sorcier transforme la jouvencelle en animal. Afin de conjurer le sortilège, le jeune homme entame une quête dont le but est de solliciter la « fée des caresses, » chose parfaitement inutile puisqu'il paraît que l'amour entre un homme et une femme est plus fort que toutes les magies (quelle buse ce fils d'architecte !). Enfin on apprend au passage que la gentillesse envers les animaux est une noble chose, parfois profitable.
Raphaël Jodeau